Il aura suffi d’une apparition pour enflammer la toile. En mars dernier, à New York, Miley Cyrus fait son entrée dans le mythique Carlyle Hotel pour un concert privé, drapée dans une silhouette crème et or brodée à la main, à la structure aussi sculpturale que poétique. Il n’en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux algériens et qu'une partie de la presse nationale s’emballent : “Elle porte un karakou !”. L’enthousiasme est immédiat, presque instinctif. La broderie dorée, la veste cintrée, la jupe fendue… le regard algérien croit reconnaître l’ombre d’un vêtement bien plus familier qu’il n’y paraît.
Mais derrière cette ressemblance troublante se cache une réalité bien différente. La tenue en question, issue du prestigieux défilé Thom Browne Haute Couture Automne-Hiver 2024–2025, n’est pas une réinterprétation du karakou, du moins, pas consciemment ! Et c’est justement dans cette confusion visuelle que réside toute la subtilité d’un débat fascinant entre mémoire culturelle, projection identitaire et haute couture contemporaine.
Une création signée Thom Browne
La tenue que portait Miley Cyrus lors de son apparition new-yorkaise provient en réalité du défilé Thom Browne Haute Couture Automne-Hiver 2024–2025, présenté au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Cette information, désormais confirmée, rebat les cartes : loin d’un emprunt culturel maghrébin, il s’agit d’une pièce de haute couture imaginée par un créateur américain réputé pour ses expérimentations autour du tailoring et de l’anatomie du vêtement. Ce qui a sans doute semé la confusion, c’est cette combinaison de trois éléments visuellement évocateurs : une veste cintrée, une broderie dorée et une jupe longue assortie. Des éléments que l’on retrouve effectivement dans le karakou algérois, tenue emblématique du patrimoine algérien.
Mais réduire cette création à une simple “version occidentale” du karakou serait une erreur de lecture. Car si l'association veste + broderie évoque brièvement le célèbre habit d’apparat algérien, le langage stylistique global de cette tenue appartient à un tout autre registre.

Un style qui trouble la perception
Ce qui a pu semer la confusion ? L’association d’éléments visuels forts : épaules marquées, boutons brodés façon "maqass", ornementation dorée en relief, silhouette sablier... autant de caractéristiques que l’on retrouve dans le karakou algérois, emblème du vestiaire nuptial algérien. Mais ici, pas de "fetla", pas d’arabesques symétriques, ni d’intention revendiquée.
Un ADN résolument européen
Col montant rigide, épaules bien dessinées, taille cintrée et structure architecturale : la pièce que porte Miley rappelle davantage les vestes victoriennes du XIXᵉ siècle que les traditions maghrébines. Ces vestes de l’époque, portées par les femmes de la bourgeoisie britannique, se distinguaient par leur corseterie intégrée, leur brocart raffiné et leur volonté de structurer la silhouette en sablier. Exactement ce que l’on observe ici.
Le concept de couture inachevée
Pour cette collection, Thom Browne a choisi de travailler exclusivement la mousseline de coton, un tissu normalement réservé à la confection de toiles de prototypes. Sa démarche ? Explorer l’essence du vêtement, en exaltant les étapes de construction plutôt que le résultat final. Chaque look, dont celui de Miley, est pensé comme une “œuvre en cours”.
La pièce en question a nécessité plus de 11 000 heures de travail et mobilisé 42 artisans. Les broderies duveteuses forment des motifs denses et texturés qui flirtent visuellement avec l’esthétique du luxe oriental, sans toutefois s’y inscrire explicitement. Le vêtement est à la fois théâtral et maîtrisé, entre hommage à la statuaire antique et audace couture contemporaine.
Quand la broderie s’impose, au lieu de dessiner
S’il fallait identifier un point de rupture fondamental entre le karakou algérien et la pièce portée par Miley Cyrus, ce serait dans le traitement de la broderie. Car au-delà des dorures et du clinquant apparent, tout oppose leur langage ornemental.
Dans la tradition algérienne, la broderie est pensée comme une écriture textile. Elle compose des motifs clairs, symétriques, souvent géométriques : arabesques maîtrisées, fleurs stylisées, palmettes, constellations ciselées au fil d’or. Elle suit une logique de composition équilibrée, avec des pleins et des vides, laissant au tissu (velours, soie ou brocart) le soin de respirer. Chaque motif est précis, délimité, graphique.
La broderie imaginée par Thom Browne, en revanche, relève d’un tout autre registre. Elle est foisonnante, presque sauvage, s’étalant en nappes continues sur l’ensemble du buste et des épaules, sans symétrie ni structure apparente. Plutôt qu’un dessin, on y lit une matière en mouvement, comme un nuage doré pulvérisé, une mousse scintillante en expansion. Le rendu évoque davantage une éruption baroque ou une vision néogothique, à la manière des grandes heures de McQueen ou d’Iris Van Herpen, que l'élégance codifiée du karakou.
Ici, la broderie ne décore pas : elle envahit, elle absorbe, elle dramatise. Le créateur y mêle un travail de perlage minutieux à la technique rare de la broderie au crin de cheval, traditionnellement pratiquée par la minorité Shui du Guizhou en Chine, un art classé au patrimoine immatériel de l'humanité ! Ce choix textile audacieux, presque tactile, confère à la surface une dimension organique et mouvante, loin des broderies du karakou. Ce parti-pris esthétique, pleinement assumé, confirme que l’intention n’était pas celle d’une citation patrimoniale, mais celle d’une couture expérimentale, sensorielle et performative, à la croisée du costume d’art et de la sculpture textile.
Un karakou fantasmé ?
Il est fascinant de constater à quel point cette création a résonné au sein de la communauté algérienne. Comme un mirage textile, elle évoque un karakou modernisé, celui que l’on pourrait voir dans les défilés de Menouba ou Yasmina Chellali. Mais cette proximité est purement formelle. Thom Browne ne cite pas l’Algérie, ni le Maghreb, parmi ses inspirations. Il parle de "muscles brodés", de "coiffures sculptées comme dans les statues antiques", et de références aux Jeux Olympiques".

Une émotion révélatrice
La réaction passionnée de certains médias ou internautes algériens en dit long sur notre désir de reconnaissance culturelle. Mais cette volonté, légitime, ne doit pas nous conduire à des amalgames esthétiques trop rapides. Le karakou mérite mieux que des comparaisons approximatives. Il mérite d’être reconnu pour ce qu’il est : une pièce d’exception, codifiée, porteuse d’histoire, de géographie et de savoir-faire local.
Faut-il donc y voir une appropriation culturelle ? Pas dans ce cas précis. Honnêtement, il est peu probable que ce styliste se soit directement inspiré du karakou. Il s’agit d’un glissement visuel non intentionnel. Mais comme souvent dans la mode, les formes se croisent, les références se frôlent. La silhouette de Miley, par sa noblesse, sa verticalité, son éclat discret, peut en effet réveiller une certaine mémoire visuelle chez les Algériennes, sans pour autant revendiquer une filiation authentique.
Et si cette silhouette était finalement une belle coïncidence ? Une invitation à faire entendre davantage nos savoir-faire, à nommer nos influences, à revendiquer nos héritages textiles. Le karakou ne demande pas à être imité, il mérite d’être vu, compris et célébré pour ce qu’il est.
Mais cela soulève une question plus large sur la manière dont les codes vestimentaires circulent sans toujours être crédités.

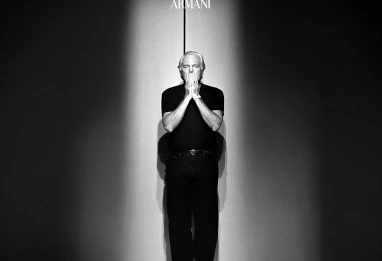





Aucun commentaire pour le moment
Votre avis compte. Lancez la conversation