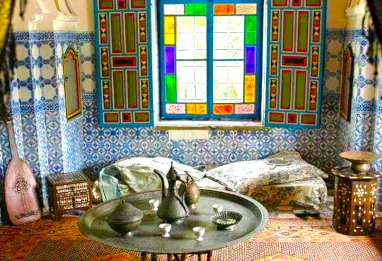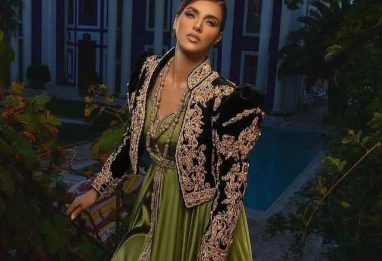Sherryfa · 25 novembre 2013 à 09h36
« Je me sens un peu l’otage d’une dynamique balbutiante. Elle est dispersée, éclatée et embryonnaire, teintée de désespérance mais elle existe ». C’est ainsi que Djilali Hadjadj parle de son obstination à continuer son combat contre la corruption, qui gangrène le pays, malgré ses nombreuses désillusions.
Actuellement porte-parole de l’Association algérienne de lutte contre la corruption (AACC), il s’est investi dans cette lutte depuis plusieurs années. D’abord en tant que journaliste au début des années 1990, avec Le Matin et El Watan. Il venait de quitter Sonatrach, en 1993 où il travaillait en tant que médecin. « C’est vrai que quand vous êtes médecin dans la compagnie, on vous offre les conditions idéales mais je ne voulais plus m’occuper de l’allergie aux langoustes de la femme du vice PDG », ironise-t-il, un grand sourire aux lèvres.
Premières poursuites judiciaires
Djilali Hadjadj s’intéresse d’abord aux dysfonctionnements dans le secteur de la santé, du marché des médicaments, celui des vaccins et des appareils médicaux. « La mafia du médicament m’effrayait mais je pensais qu’elle existait uniquement dans certains pays européens et je la découvre chez nous », raconte-t-il.
En 1995, il publie une enquête sur le marché des vaccins. « J’ai découvert des horreurs : on achetait des vaccins aux prix forts. Non seulement, ils se remplissaient les poches mais ils achetaient des produits qui n’étaient pas du tout conformes. Cela voulait dire que 800 000 nouveau-nés se retrouvaient sans couverture vaccinale et ainsi exposés aux maladies les plus effroyables », explique-t-il. Ses enquêtes lui valent des poursuites judiciaires qui ont duré plusieurs années. Mais pas seulement…
Harcèlement, intimidations et menaces de mort
Enquêter dans l’Algérie des années 1990, pendant la décennie noire du terrorisme, exposait le journaliste à toutes sortes de dangers. « Les gens étaient vraiment vaches ! Et il y a eu une période très difficile pour moi et pour les miens », se souvient Djilali Hadjadj. Au milieu des années 1990, des agents de la police se sont rendus à l’établissement scolaire où enseignait sa femme et ont demandé son dossier. Ils se sont déplacés également au lycée Amara Rachid pour chercher le dossier de sa fille.
En 1996, la brigade antiterroriste de la police s’est rendue à son domicile vers 22 heures. Motif ? Chercher son fils, âgé alors de 14 ans, pour une affaire de soutien au terrorisme. « Ça faisait partie des intimidations et des menaces. Ma femme a été virée de l’Éducation nationale début des années 2000 », explique-t-il. Quand il déposa plainte contre X après avoir reçu des menaces de mort, la réponse de la police était intrigante : « Non, on vous connaît, ça n’a rien à avoir avec le terrorisme ». Avec le temps, ce père de trois enfants se dit : « On n’a pas le droit d’avoir une famille quand on mène un combat pareil ».
Fin de sa collaboration avec El Watan
La vie n’a pas été toujours facile pour Djilali Hadjadj. Mais ça n’a pas altéré sa détermination. Bien au contraire. En mars 1999, il publia "Corruption et démocratie en Algérie" (réédité en 2001). Un livre où il évoque les mécanismes de la corruption "à l’algérienne" depuis l’indépendance avec le " trésor du FLN" jusqu’à la fin des années 1990. « Il a été édité en France parce que personne n’a voulu l’éditer ici », dit-il. Le groupe Hachette a pu commercialiser la deuxième édition en Algérie. « J’avais fait des séances de vente-dédicace dans des librairies. Et j’avais l’impression que quelqu’un pouvait rentrer pour me tirer dessus. C’était le cauchemar de ma vie », avoue-t-il.
Après la sortie du livre et une série d’interviews, la direction d’El Watan mit fin à la collaboration avec Djilali Hadjadj (en novembre 1999). Il dit se poser toujours la question sur les raisons ayant motivé une telle décision, même s’il apporte une certaine réponse dans la deuxième édition de "Corruption et démocratie". « Ça a été en tout cas une blessure terrible sur le plan professionnel, au moment où je ne m’y attendais pas », assure-t-il. rnMais « ce qui ne tue pas, rend plus fort ». Cette phrase culte de Nietzsche dans "Le crépuscule des idoles" peut s’appliquer parfaitement au parcours, semé d’embûches, de ce militant anti-corruption. Il intègre alors Le Soir d’Algérie où il anime depuis plus de dix ans deux pages hebdomadaires, l’une consacrée aux retraités, et l’autre à la corruption en Algérie et dans le monde.