Et si la peur de réussir était plus forte que le désir de réussir ? Et si l'échec n'était pas un hasard, mais un choix inconscient pour ne pas se confronter à la lumière ? Plongeons dans les méandres de l'auto-sabotage avec un récit incarné et des clés pour avancer.
Provoquer l’échec, un mécanisme insidieux
C’était pourtant bien parti. Le plan était clair, les efforts constants, l’envie sincère. Et puis, sans que tu comprennes vraiment comment, quelque chose a déraillé. Tu as ralenti. Reporté. Oublié. Tu t’es dispersée. Et l’objectif s’est éloigné, comme sabordé par tes propres mains. Ce scénario, tu ne l’as pas subi. Tu l’as orchestré, inconsciemment. On appelle ça l’auto-sabotage.Ce mécanisme invisible touche plus de femmes qu’on ne le croit. Il se manifeste dans mille petits gestes : une procrastination déguisée, un perfectionnisme paralysant, une phrase assassine soufflée à soi-même. Derrière chaque pas en arrière, il y a une peur. Celle d’échouer, bien sûr. Mais aussi – et peut-être surtout – celle de réussir. Car réussir, c’est se rendre visible. C’est s’exposer au regard, à la critique, à l’envie. C’est se mettre à nu. Et parfois, le prix semble trop lourd à payer.
Alors, on préfère rester dans la zone de confort, là où l’on maîtrise, là où l’échec est familier et donc moins douloureux. On décline une opportunité, on manque un rendez-vous clé, on ne répond pas à ce message qui pourrait tout changer. L’échec devient une stratégie de protection. Une manière de garder le contrôle. Mais ce contrôle est illusoire.
À force de saboter ce qui pourrait nous élever, on s’enferme dans l’immobilisme. On nourrit la frustration, l’auto-dénigrement, l’impression d’être « toujours au même point ». Et cela devient un cercle vicieux : plus on s’auto-sabote, plus on croit qu’on n’est pas capable, et plus on répète ce schéma.
Sortir de l’auto-sabotage commence par une prise de conscience. Par se demander : "qu’est-ce que je fuis vraiment ?" Suis-je en train d’échouer… ou de me protéger ? Ce n’est pas une faiblesse. C’est une peur qu’il faut apprivoiser. Il ne s’agit pas de tout réussir. Il s’agit de ne plus avoir peur d’essayer, ni d’être vue.
L’échec n’est pas l’ennemi. Le vrai danger, c’est de ne jamais se donner la chance de briller.
Des racines profondes dans l'enfance
L’auto-sabotage ne naît pas de nulle part. Il trouve souvent ses origines dans des expériences précoces, celles qui laissent une empreinte silencieuse mais tenace dans notre psyché. Un parent trop exigeant qui n’applaudit jamais vraiment, une réussite banalisée ou perçue comme arrogante, une parole rabaissante qui s’est logée là, entre la poitrine et l’estomac. Dans ces moments-là, l’enfant comprend quelque chose de crucial : réussir, c’est prendre un risque. Celui d’être jugé, moqué, ou pire encore… abandonné.
Alors il développe un réflexe : mieux vaut décevoir un peu, que de tout perdre d’un coup. Il apprend à réduire ses élans, à contenir ses ambitions, à doser sa lumière. Il ne veut pas briller trop fort. Il veut rester en sécurité. Et ce conditionnement, inscrit dans le corps comme une mémoire de survie, continue d’agir bien des années plus tard, sans même qu’on en ait conscience.
À l’âge adulte, ce schéma s’infiltre partout. On décline une opportunité par peur de ne pas être « assez ». On s’arrête à mi-chemin pour ne pas trop espérer. On choisit inconsciemment un emploi moins exposé, une relation tiède, un rêve raisonnable. Ce n’est pas la paresse, ni le manque de talent. C’est une blessure ancienne qui dicte encore la marche à suivre.
Pour certaines personnes, ce réflexe devient une identité. "Je suis comme ça", "Je ne réussis jamais", "Je n’ai pas de chance". Ces phrases, répétées en boucle, deviennent des croyances limitantes. Le cerveau, qui déteste le désaccord interne, va chercher à confirmer ces pensées. Il sélectionne les informations, interprète les situations, crée même les conditions pour valider ce qu’il croit vrai. C’est ce qu’on appelle la prophétie autoréalisatrice.
On sabote alors, sans s’en rendre compte, tout ce qui pourrait contredire notre histoire intérieure. On arrive en retard à l’entretien important. On rend un dossier bâclé. On choisit un partenaire qui nous traite mal. Et on se dit, en soupirant : "Tu vois, je l’avais bien dit." Mais ce n’est pas la réalité qui prouve notre incompétence, c’est notre peur qui construit cette réalité.
Briser ce cycle demande du courage. Il faut remonter aux racines, regarder les peurs en face, interroger les messages que l’on s’est laissé murmurer trop longtemps. Il ne s’agit pas de tout effacer, ni de prétendre que le passé n’a pas existé. Il s’agit de reprendre le pouvoir. De faire taire, peu à peu, la voix intérieure qui sabote. Et de faire confiance, enfin, à celle qui rêve.
Les bénéfices cachés de l'échec
En psychologie, on parle de "bénéfices secondaires". Ce sont les avantages que l'on tire inconsciemment d'une situation apparemment négative. L'échec, par exemple, peut attirer la compassion, éviter les responsabilités, justifier l'inaction. Il devient un refuge familier.
On reste dans une relation toxique pour ne pas être seul. On refuse une promotion pour ne pas s'éloigner de ses collègues. On échoue à un projet pour ne pas confronter ses vraies ambitions. L'échec est un manteau qui cache la peur, mais aussi un abri contre la nouveauté.
Ces stratégies sont souvent inconscientes. Elles protègent une estime de soi fragile, ou évitent un saut dans l'inconnu. Mais à long terme, elles enferment. Elles créent de la frustration, du regret, une impression d'être spectateur de sa propre vie.
Comment sortir de ce schéma ?
Sortir du cercle de l’auto-sabotage n’est pas une course. C’est un chemin, souvent long, parfois inconfortable, mais profondément libérateur. La première étape, la plus essentielle, c’est la prise de conscience. Reconnaître, sans te blâmer, que certaines chutes, certains blocages, ont peut-être été provoqués par toi-même. Non pas par faiblesse, mais par peur. Non pas par incapacité, mais par instinct de survie. C’est un mécanisme de protection. Inconscient, mais puissant.
Alors, pose-toi. Reviens sur ces moments où tu as freiné sans raison apparente. Où tu as procrastiné. Où tu as fui une opportunité, sabordé une relation, bâclé un projet. Et demande-toi en toute honnêteté :
- Que craignais-tu vraiment, au fond, dans cette situation ? L’échec ? Ou la réussite ?
- Qu’est-ce que cet échec t’a permis d’éviter ? Une exposition trop grande ? Le jugement ? Une charge nouvelle ?
- Qu’aurait impliqué la réussite ? Une version de toi plus visible, plus responsable, plus engagée ? Es-tu prête à incarner cette version ?
- As-tu peur de la jalousie, du regard des autres, de te retrouver seule dans cette nouvelle lumière ?
Ces questions ne sont pas anodines. Elles remuent, grattent les couches profondes de ton histoire personnelle. Elles réveillent peut-être des souvenirs, des blessures anciennes. Mais c’est précisément là, dans cette introspection honnête, que commence la libération. Car on ne peut pas changer ce qu’on ne voit pas.
Ensuite, il faut apprivoiser cette peur. La regarder en face, la nommer, et lui parler. Tu peux lui dire : "Je te vois. Je sais que tu veux me protéger. Mais je n’ai plus besoin de toi comme avant." Cette peur n’est pas une ennemie. Elle est une messagère. Elle t’indique ce que tu crois encore dangereux : briller, être aimée, réussir.
Le travail peut passer par l’écriture, la thérapie, le coaching, ou simplement des temps de solitude consciente. L’essentiel est d’ancrer de nouvelles croyances. Des phrases simples mais puissantes : "Je suis capable", "Je mérite de réussir", "Je peux briller sans être rejetée", "Je n’ai pas à choisir entre amour et réussite".
Et surtout, avance. Même lentement. Même avec la peur. Car le changement ne vient pas d’un coup de baguette magique, mais de petits choix répétés. Chaque fois que tu oses, malgré la voix du doute, tu affaiblis l’ancien schéma. Et tu dessines, à ton rythme, une nouvelle manière d’être au monde : plus libre, plus confiante, plus alignée avec qui tu es vraiment.
Réécrire le scénario
Transformer les mécanismes d’auto-sabotage ne se fait ni par la force, ni par la volonté brute. Cela commence souvent par un geste de tendresse envers soi-même. Une réconciliation intérieure. Car au fond, il ne s’agit pas seulement de réussir. Il s’agit d’accepter d’être visible. De supporter sa propre lumière sans rougir. De se donner, enfin, la permission d’exister pleinement.
C’est un acte profondément intime que de se dire : « J’ai le droit de briller. Même si cela dérange. Même si cela suscite des regards, des attentes, ou des jugements. » Car la réussite, lorsqu’elle est alignée, n’est jamais arrogante. Elle devient juste. Naturelle. Une conséquence logique de qui tu es.
Pour y parvenir, il faut parfois réécrire le scénario que l’on joue depuis des années. Changer de rôle. Cesser d’être celle qui se retient. Commencer à être celle qui ose. Et cela peut commencer par de petits actes symboliques, presque invisibles : postuler à une offre malgré le trac, prendre la parole en réunion, s’inscrire à une formation, dire non à ce qui abîme, demander de l’aide sans honte. Ces gestes sont des graines de confiance que l’on plante dans un nouveau sol.
Mais on ne change pas seule. Il est essentiel de s’entourer d’alliés. De personnes qui voient en toi ce que tu peines parfois à reconnaître : ta valeur, ta force, ta beauté. Le regard bienveillant de l’autre peut être un levier puissant. Il reflète une image plus grande, plus lumineuse, qui t’encourage à sortir de l’ombre. Ces relations sont précieuses. Nourrissantes. Ce sont elles qui, souvent, permettent de tenir quand l’ancien schéma tente de reprendre le dessus.
Réécrire son scénario, c’est aussi prendre soin de sa narration intérieure. Changer le discours mental. Remplacer les « Je n’y arriverai jamais » par « Je peux essayer ». Les « Je suis trop » par « Je suis assez ». Et surtout, se rappeler que le courage, ce n’est pas l’absence de peur. C’est avancer avec elle, main dans la main.
En somme, provoquer l'échec est un réflexe de protection. Mais la vie, elle, demande d'oser. D'avancer, même tremblante. De rater parfois, mais en conscience. Et surtout, d'accepter d'être aimée, vue, valorisée.
L'échec ne disparaîtra pas. Mais il ne sera plus un piège. Il deviendra un passage, une étape, une leçon. Alors tu pourras enfin te dire : j'ai le droit de réussir.

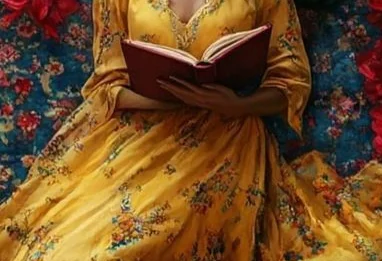



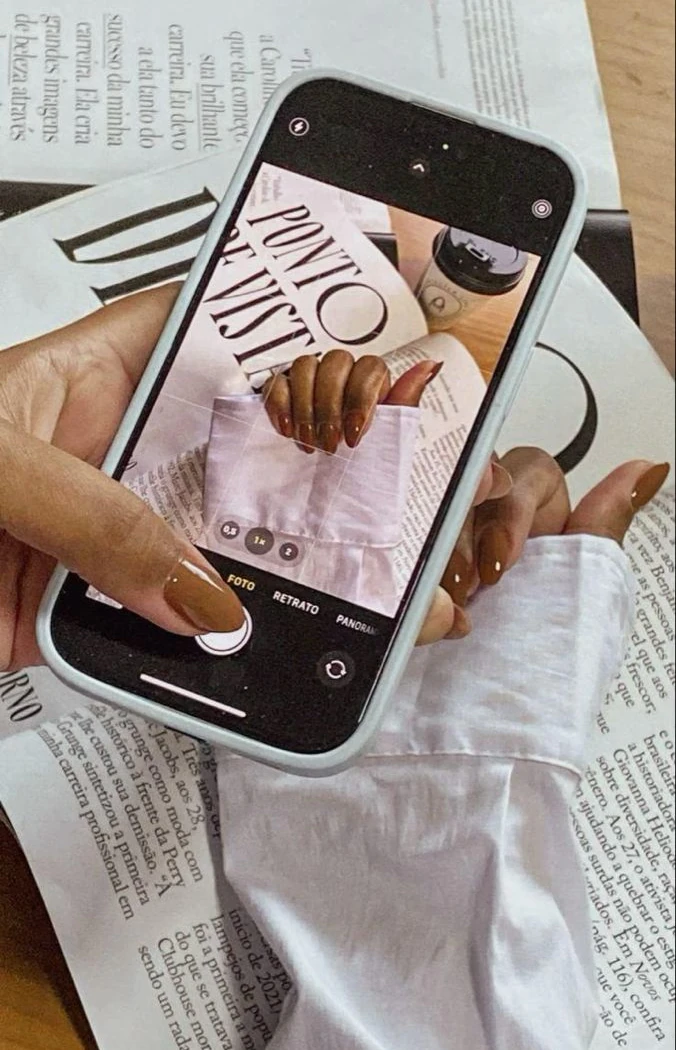


L'histoire de ma vie